
Photo: Laurent Méliz
…en librairie le 7 mars 2024…en librairie le 7 mars 2024…
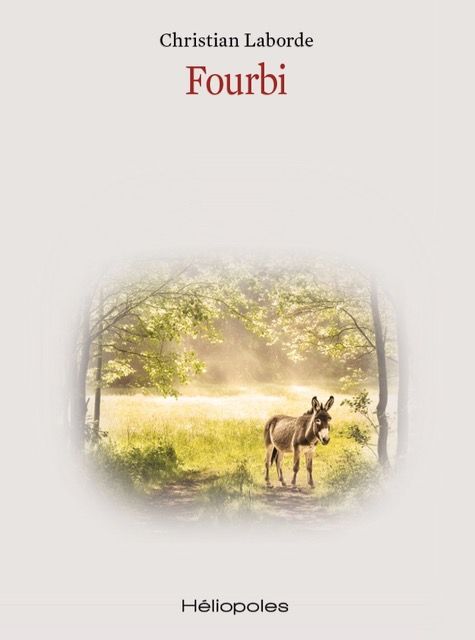
couverture: Lou Rivet
« Quand le monde s’envoie des fusées de détresse à coups de Space X, prendre le monde à hauteur d’âne est une rébellion poétique majeure »
Laurent Rochut

Poésie & Textes courts
1
Que trouve-t-on dans le Fourbi de Laborde ? Un récit poétique, des nouvelles, des poèmes, des notes, des sagaies, des vagabondages, des fantaisies syllabiques. Ce Fourbi est d’un poète qui savoure l’ombre d’une départementale, console la pluie, s’insurge contre le sort réservé aux bêtes et se souvient de Jacqueline Bisset au volant de son cabriolet Porsche 356 C dans Bullitt. A l’heure où prolifère, à la façon des algues vertes, la prose sans vertèbres ni saveur, Christian Laborde nous invite au pays des mots qui dansent et chantent.

2
Entretien avec l’auteur

-Et si l’on commençait par le titre, Christian Laborde : pourquoi Fourbi ?
-C’est mon oreille qui a choisi. Fourbi est un mot bien fichu, fait pour la bouche. L’oreille d’abord, puis le dico. Il dit quoi, le dico ? Il dit : « Fourbi : ensemble des effets, des armes d’un soldat ». Toutes mes armes sont dans ce livre, tous mes effets réunis sous cette couverture.
-Fourbi signifie aussi désordre : « c’est quoi, ce fourbi « ? Or votre Fourbi est ordonné, construit en trois parties : « Le gardien de Magardo », « La consolation de la pluie », et « Bulles, balles, buées ». Quels sont les points communs entre les textes – récit, nouvelles, poèmes, portraits, aphorismes, vagabondages, interventions – de ce Fourbi ?
– J’en vois deux : la poésie et la brièveté. Je loue, je célèbre, je chante : j’écris avec un saxophone. Je privilégie le jaillissement, l’instant, le rythme, je refuse la traînaillerie syllabique des fictionneurs : j’écris avec une gomme.
-Vous célébrez notamment la nature. Elle est très présente dans Fourbi.
-La nature, j’ai toujours eu besoin d’elle, et maintenant c’est elle qui a besoin de moi.
-On vous voit en effet dans Fourbi consoler la pluie, venir à son chevet…
-Où voulez-vous que le poète se tienne, aujourd’hui, sinon au chevet des arbres, des pierres, des glaciers, du vent qui erre comme une âme peine entre les abribus ?
-Que vous apporte la nature, que vous apportent ces départementales que vous sillonnez sur votre vélo ?
-Elle m’apporte tout ce dont la société d’aujourd’hui me détourne, tout ce qu’elle interdit. Par exemple la lenteur. Elle m’invite à prendre mon temps, et sa fréquentation me permet de ne pas perdre de vue l’enfant que je fus, et donc de rester vivant. Quand je roule, mains aux cocottes, je sens la présence du monde autour de moi, et cette présence me rapproche de moi-même.
-Et la ville, les villes ? il y a encore quelques rues, quelques places dans Fourbi.
-J’ai beaucoup aimé la ville quand elle était le domaine du merveilleux, quand elle accueillait la nuit. J’aime la ville dans Le Paysan de Paris d’Aragon, dans un poème de Richard Brautigan. Aujourd’hui, la ville est surtout le territoire des injonctions sociales qui s’enchainent et nous enchaînent à tout ce qui n’est pas nous-mêmes. Et dans les rues de la ville d’aujourd’hui, que voit-on passer ? Des enfances factices en trottinettes, et des esclaves roulant à fond les ballons, une glacière sur le dos, sous l’œil des caméras de surveillance.
–Fourbi paraît au moment du Printemps des poètes : que ferez-vous durant ce Printemps ?
-Je pousserai la porte des librairies, des médiathèques, des bar-épiceries-journaux, des théâtres, et je dirai les textes de Fourbi. Je les dirai par exemple au Comptoir de la poésie à Saint-Lary, dans les Pyrénées, au milieu des flocons de neige. Seule la poésie peut faire concurrence à la neige.
-Vous aimez dire les mots…
-Oui. Je suis profondément un conteur, un tchatcheur, un costaud de la luette : ah luette, gentille luette, ah luette, donne-moi des mots, des mots chauds comme les bosses du chameau ! Les mots, c’est la bouche. Elle les fait naître, sonner, et s’envoler. Et seul
La presse

Un fourbi où il fait bon se perdre
Le dictionnaire nous apprend que le joli vocable de « fourbi » désignait à l’origine le barda du soldat, réunissant ses armes et son paquetage. L’écrivain et poète Christian Laborde, barde du cyclisme et frère spirituel de Claude Nougaro, dont il célèbre la mémoire dans un one-man-show, n’a qu’une arme sur lui et dans le cœur : les mots. Dans son Fourbi, on tombe sur des souvenirs de jeunesse, des visages, des amours et des rencontres. Celui qui n’a jamais dévié du chemin menant à la liberté d’être soi y garde aussi des images cueillies dans la rue ou aux terrasses des cafés, des Angélus qui colorent le ciel, des choses disparues ou en passe de l’être…C’est écrit avec cet accent haut-pyrénéen, tout en pleins et déliés, qui polit les galets dans un scintillement de ruisseau.
Pierre Vavasseur 20 avril 2024

« Christian Laborde, compositeur es-lettres, manie le verbe avec une fantaisie débridée et une érudite délicatesse. »
Véronique Fourcade, Sud-Ouest, 28 mars 2024

Alors que le troisième millénaire a commencé sous de mauvais auspices entre une pandémie et une guerre qui résonne au bout de l’Europe, Christian Laborde nous propose de fouiller dans son « Fourbi » pour y voir l’essentiel. C’est à dire tout ce qui fait sens à travers les mots, la nature, le vent, la pluie. Tout ce qui nous relie à notre humanité et qui passe par la langue, un regard, un ressenti. Christian Laborde est un poète. Qu’est-ce un poète en ces temps où la langue se dessèche ? S’il sait manier la rime, un poète, aussi emmerdant soit-il, marche le plus souvent en gueulant contre la connerie et les bien-pensants. Un poète ouvre les horizons et fait entrer la lumière dans les âmes. C’est ce que fait Christian Laborde.
Pascal Hébert, 24 mars2024

Christian Laborde qui publie le recueil « Fourbi » (Héliopoles), ne manque jamais une occasion de déclamer ses textes et poèmes sur scène « en faisant parler les e muets », comme dirait son ami Claude Nougaro.
Justine Briquet Moreno, Elle, 16 mars 2024

« L’auteur bigourdan installé à Pau récidive entre nouvelles, poésies et pensées jetées avec brio: Christian Laborde déballe son FOURBI, et c’est jubilatoire »
Nicolas Rebière, La République des Pyrénées, 6 mars 2024

Je parle de Claude Nougaro et de FOURBI au micro de Jacques Pessis
Lundi 5 mars 2024

« C’est à croire que certains « territoires » ont le chic de rendre leurs habitants heureux comme des poètes. Prenez Saint-Lary-Soulan, dans les Pyrénées. De cette belle altitude nous arrivent deux bonnes nouvelles : le choix de remettre un prix à notre collaborateur Jérôme Leroy dans le cadre du Printemps des poètes(du 9 au 23 mars), et l’annonce, par Christian Laborde, résidant inspiré, d’une nouvelle parution, FOURBI, aux éditions Héliopoles »
Marianne 20 février au 6 mars 2024

4 mars 2024

Là-haut, sous les étoiles

Christian Laborde, poète et grimpeur palois, déballe son « fourbi », nouvelles et poèmes, dans un recueil irisant aux éditions Héliopoles
La poésie est une chose trop sérieuse pour la laisser aux poètes officiels. Les encartés et les pétitionnaires manquent de vent et de souffle dans leurs vers. La poésie n’a que faire des ordres et des cases, des prébendes et des idéologies, c’est un foutoir qui ne tient qu’à un fil, un élan chaotique et des désirs contraires. La poésie ne suit aucune logique, aucun manuel, ne s’acoquine d’aucun parti et se méfie des censeurs enivrés de pureté. La poésie n’admet en son sein que les fous et les possédés, les émotifs et les flâneurs, les pêcheurs de truite et les emmurés des achélèmes, les trublions et les sensuels. Les inadaptés y trouvent un refuge, une halte, un abreuvoir dans le désert, on s’y désaltère, on s’y noie un instant et après, on doit repartir et affronter toutes les raideurs du système, tous les obturateurs de la pensée. Sans elle, sans cette respiration essentielle, que serions-nous ? Des lecteurs d’essais statistiques ou pis, de biographies d’hommes politiques. La poésie ne recrute pas sur concours administratif et après avis médical. On attend d’un poète, un style, un son, une imagerie, des emportements, des lassitudes, un épuisement et cette lumière blanche qui illumine une clairière, à l’abri des regards. En somme, des mystères et des égarements. On aime Christian Laborde pour sa science vélocipédique, pour son long compagnonnage avec Claude Nougaro et, pour son œuvre, large et ample, foutraque et incandescente, rocailleuse et désarticulée, pleine de ruisseaux et de montagnes, de jazz et de percussion, de foins et de vaches, d’embardées provinciales et de picotements urbains. C’est le grand percussionniste des lettres françaises, batailleur, toujours en verve et en émoi, jamais tranquille, sur la brèche, j’entends son accent débouler dans un studio de radio, le débit est précis, l’enthousiasme n’est pas feint, cette cascade de mots déferle et nous emporte. Les poètes qui aiment les mots ne sont pas légion en France. La plupart s’en méfie. Laborde les fait tinter au clair de lune. Il est précoce, cette année. Il arrive avant les premiers bourgeons du printemps. Son « Fourbi », recueil de nouvelles, poèmes et instantanés aux éditions Héliopoles sent l’herbe coupée et les brisures d’enfance, il est empreint d’un romantisme sensitif et parsemé de quelques saines colères. Laborde est le chantre d’une nostalgie qui construit plutôt que celui d’une nostalgie mortifère. Le livre débute par une longue nouvelle « Le gardien de Magardo », récit d’une éducation campagnarde, d’une solitude qui s’apprivoise au contact d’adultes bienveillants et d’animaux complices, s’en dégage une pudeur extrême où rien n’est déballé, rien n’est sali, cette retenue-là est précieuse pour le lecteur. Elle l’honore. Laborde excelle dans cette composition où tout est suggéré, effleuré et pourtant tout est dit. Il aurait pu choisir les larmes, les repentances, les vociférations intimes ; là, il écrit comme parlaient nos instituteurs de jadis, sans passéisme, avec une force de conviction. Il y est question d’amour de la langue française, de transmission, d’un contact direct et pas du tout évanescent avec la nature, de son assujettissement joyeux, Herping, l’ânon qui pointe ses oreilles sur la couverture est un frère pour le jeune narrateur, honnête homme en construction qui se méfie d’instinct d’une modernité obscène. On est chez Giono et Hardellet, du côté de Boudard et de Pirotte également, les souvenirs de la guerre planent encore sur les consciences, Jeanne et Auguste veillent sur son destin et puis, il y a les fulgurances de Laborde comme cette phrase parfaite d’harmonie champêtre : « Nous allions herboriser en 2CV » ou cette maxime que l’on devrait inscrire au fronton des écoles : « En ces temps pourris, seuls les deux G, Gracq et Gary, vous tiendront compagnie ». Laborde passe habilement de Bir Hakeim à la Porsche 356 de Jacqueline Bisset dans « Bullit ». Ce « Fourbi » me rappelle le bazar ambulant qui s’installait, les jours du marché, sur la place de mon village dans le Berry. On y trouvait toutes sortes de merveilles, des pépites à un franc seulement. Dans cet ouvrage hybride qui se moque des catégories et des compartiments, Laborde voyage librement, après une longue nouvelle, il nous offre des poèmes sur des sujets aussi variés que la pluie, Procol Harum, le rue Bréguet ou la ville d’Albi et, dans une dernière partie qu’il appelle ses vagabondages, ses polaroïds, sous forme de portraits courts, photographient le déséquilibre du monde. Laborde est un poète généreux.
Thomas Moralès, Causeur, 3 mars 2024

« La poésie n’est jamais très loin pour Christian Laborde qui aime la sonorité du mot, la force du verbe et le relief de la ponctuation, comme l’illustre délicieusement son dernier opus: FOURBI. »
Stéphane Boularand, La Dépêche du Midi, dimanche 3 mars 2024

« Des nouvelles, des aphorismes, des poésies, le FOURBI de Laborde c’est la fête du bref »
Sébastien Dubos, Midi, dimanche 3 mars 2024
C’est ma Tournée

Je présenterai, dirai, signerai FOURBI à
– Sorde l’Abbaye, le 17 février.
– Saint-Lary, 13 et 23 mars.
– Biarritz, le 30 mars.
– Tarbes, le 4 avril.
– Pau, le 8 avril
–Paris,12,13, 14 avril, Salon du Livre
– Séméac, le 20 avril.
– Montauban, le 27, 28 avril.
–Toulouse, le5 mai
–Argelès-Gazost, le 11 mai.
–Paris 19,20 mai, Marché de la Poésie Saint-Sulpice
J’ai recousu la robe de la nuit
avec du fil de pêche
sur le parking d’Auchan
Poème, Editions du Petit Véhicule, décembre 2022
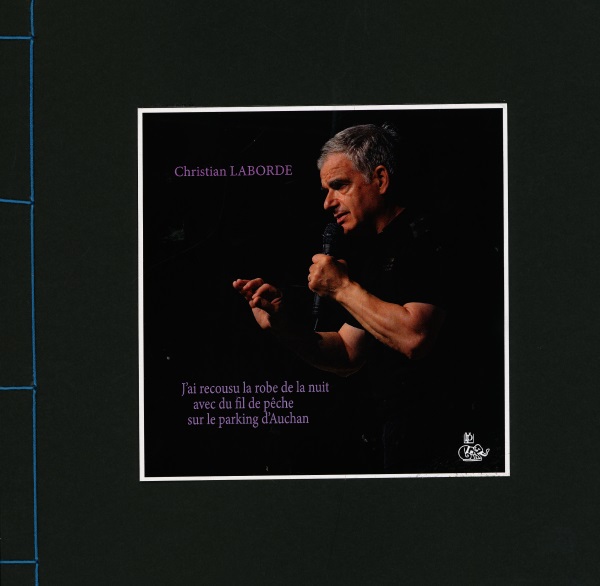

– Votre dernier roman avait un titre bref : « Bonheur ». Votre poème est, lui, doté d’un titre long. Pourquoi ce choix ?
– J’avais, cette fois, envie d’un titre qui se déplie, qui se déploie, qui ait l’envergure des grands oiseaux qui planent dans la vallée d’Aure, où je les observe, émerveillé, quand je suis à Saint-Lary. C’est surtout un titre qui dit ce que je fais : je rafistole la nuit, je recouds sa robe. Le poète rafistole la nuit, car la nuit est abimée, salie, polluée, comme la nature tout entière est abimée, salie, polluée. J’essaie de consoler la nature. Je suis le consolateur des truites et des sangliers.
–La nature est au cœur de ce poème très musical, très rythmé. La nature, la maison de Larreule.
-J’évoque beaucoup les paysages qui m’ont nourri, et cette maison de Larreule, sur les bords du Lys, qui était la maison natale de mon père. Je me souviens du bord de l’eau, du bord du toit, du bord de la fenêtre, les poules, les prairies, le vent. Et je souviens, sortant d’une télé, chez des cousins, de la voix de Petula Clark chantant « Downtown »…
–Il y a beaucoup de bords, beaucoup de chemins dans ce poème. Pourquoi ?
-Tout commence par une désertion. Au tribun qui déclare : « Je ne laisserai personne au bord du chemin », le poète répond : si, moi ! Laissez-moi, je ne vous suis pas,je choisis les bords, je choisis les chemins : je déserte. Et cette célébration des bords et des chemins, c’est une célébration de l’enfance, de la lenteur, de la nature, une nature à laquelle nous ne cessons de porter des coups. La violence faite aux arbres, aux nuages, aux rivières, aux bêtes m’affecte profondément.
–Et ces coups, vous les dénoncez…
-Oui. Je continue de louer la nature. Le souvenir de sa beauté me fait souffrir et me pousse à me porter à son chevet. Le poète chante, célèbre, rafistole. Je suis un lyrique, et ma lyre envoie des sons et des salves.
–Il y a la désertion, la célébration et, dans le dernier tiers du poème, une révolte, une jacquerie…
-Oui, la révolte, la jacquerie des bêtes. J’imagine les bêtes se révoltant, sauvant la nuit, et libérant les demoiselles de Gavarnie.
–Qui sont les demoiselles de Gavarnie ?
-Les étoiles. Les étoiles morflent autant que les oiseaux. Il était temps que les animaux s’en mêlent.
-Sur la photo de couverture, on vous voit sur scène, micro en main, à Saint-Saturnin-lès-Apt. Direz-vous ce poème sur scène ?
-Oui. La poésie, pour prendre son envol, doit être dite. La poésie, c’est la bouche, la fête de la luette. J’irai dire, « performer », slamer, tchatcher où l’on m’invitera. Il y a peu, j’étais à Bélus, dans le département des Landes et, comme il n’ y a pas de salle de spectacle, j’ai joué dans la salle du conseil municipal. Oui, j’irai dire ce poème, notamment à Saint-Lary, durant le Printemps des poètes qui se tient du 11 au 27 mars.
–L’aventure poétique continue à Saint-Lary ?
-Oui, elle continue et elle s’amplifie. Le Printemps des Poètes nous a remis le label « Village en poésie », nous organiserons une semaine Léo Ferré, et nous remettrons le Prix Saint-Lary de poésie.
(Entretien paru dans La Nouvelle République des Pyrénées, 25/01/2023)
Poésie: dans la roue du motsicien Christian Laborde

« J’ai recousu la robe de la nuit avec du fil de pêche sur le parking d’Auchan » est un long poème jazzy, percutant et chaleureux qui fait bouillir notre sensibilité.
J’ai recousu la robe de la nuit avec du fil de pêche sur le parking d’Auchan ; quel long et joli titre ! Du pur Christian Laborde . Il s’en explique, page 37, au cours de l’entretien qu’il a accordé à Luc Vidal , créateur des éditions du Petit Véhicule : « Je voulais un titre qui ressemble au poème lui-même, un titre qui, comme lui, se déplie, se déploie, un titre ayant l’envergure de ces grands oiseaux qui planent dans l’azur de la vallée d’Aure et disposent de la totalité du ciel. C’est un titre aérien, un titre qui prend la nuit sous son aile. »
L’excellent Luc Vidal, donne, dans un avant-propos éclairant, sa vision de l’œuvre : « (…) un long texte déjanté et fort équilibré en même temps, est un appel, un cri, une rumeur, une voilure. Et le poète, lui, devient un observateur, un aventurier du langage, un marin, maître de son chagrin. »
Comme à son habitude, Christian Laborde nous tient en haleine avec son rythme inimitable. Celui qu’il nous avait donné à lire, il y a peu, dans le livre poème Poulidor enfin ! (Mareuil éditions). Sa poésie tient à la fois de celle des grands créateurs de la Beat Generation, mais aussi de l’exaltation de Léon Bloy ou de la prose furieuse d’Arrabal. Elle est syncopée, possède ce beat incroyable qui ne vous lâche pas.
On prend la roue de Laborde ; on ne la lâche pas, trop content de s’adonner à ce rythme effréné, à la fois chaotique et cahotant ; la syncope n’a rien d’un malaise. Au contraire, elle engendre le bien-être. Les images en sueur éclaboussent le maillot du lecteur. « (…) je roule/mains aux cocottes/ sur le vélo frôlant les hanches de la nuit/ le vent est dans mon dos/ Je savoure une côte. »
« Les hanches de la nuit » ; comme c’est beau. Les écorces ont la couleur de réglisse. Il est le général de l’armée des rêves. « Le capitaine des truites, le capiston des cochons, le lieutenant des chats-huants… Enfant du pays de d’Artagnan, j’aurais voulu devenir mousquetaire. Mais il n’y a plus de mousquetaires… Alors je suis devenu écrivain, c’est-à-dire général de l’armée des rêves », confie-t-il encore dans l’entretien vidalien.
Sa poésie scrute aussi la nature, les saisons, les animaux. Elle dénonce également, entre les lignes, cette société ultralibérale avec ses aveuglants éclairages, et sa clinquante marchandise de racailles pour minus façon écrans géants. C’est jubilatoire ; on en redemande.
J’ai recousu la robe de la nuit avec du fil de pêche sur le parking d’Auchan, Christian Laborde, avant-propos de Luc Vidal, éd. du Petit Véhicule (150, Bd des Poilus, 44300 Nantes ; 02 40 52 14 94 ; www.lepetitvehicule.com ); 49 p. ; 20 €.
Philippe Lacoche
(10 février 2023)
Poulidor, enfin!, poème, éd. de Mareuil, juin 2022

« Raymond Poulidor a souvent été célébré. La littérature sportive regorge de pages relatant les exploits du champion français. Mais sous la plume de Christian Laborde, l’hommage se veut poétique. Au sens propre du terme…
L’écrivain, poète, chroniqueur, conteur et, surtout, amoureux des mots et du vélo, offre à son lecteur une délicieuse rasade de 679 vers pour célébrer une journée bien particulière : le 15 juillet 1974.
Ce jour-là, Raymond Poulidor signe, sans aucun doute, l’une de ses plus belles victoires de sa (très) riche carrière. A trente-huit ans… Ce jour-là, Raymond Poulidor remporte la 16e étape du Tour de France et, par la même occasion, fait entrer le Pla d’Adet, escaladé pour la première fois, dans l’histoire de la Grande Boucle.
Souvenirs, rimes, sonorités… Christian Laborde soigne ses (jolis) mots pour inviter son lecteur à prendre la roue de Poupou, à revivre cette étape jusqu’à la ligne d’arrivée :
« il a attaqué Raymond il a attaqué
sur la route que gel
en décembre mordille
et qui sous le soleil d’été se requinquille
il a attaqué Raymond il a attaqué
sur la balafre bleue
barrant la joue des monts
porté par les tambours les tamtams les klaxons
le feu des bouches folles
les flots des postillons » (…) »
Le Républicain Lorrain 29 juin 2022
Les grimpeurs du Tour de France, éd. Du Rocher 2022

« Sur la table de la salle à manger, pour une lecture tranquille sur la terrasse, un après-midi de juin inondée de soleil. Je suisabonné à Magnificat, « magnifique » publication, je lis d’anciens numéros de Miroir du cyclisme, et Christian Laborde est un très grand écrivain. » Robert Redeker
Le Bazar de l’hôtel de vie, poésie, éd. Le Castor Astral 2021

Quand la vie gambade
Christian Laborde, dans son livre de “géographie”, bat la campagne et la ville sous forme d’abécédaire. C’est un bon prétexte pour des divagations poétiques et des anecdotes musicales, cyclistes, historiques, littéraires là où Edith Piaf côtoient Francis Ponge et où se croisent Bashung et Nougaro, “phare” baudelairien de Laborde.
Existent parfois des considérations assez brillantes — sur les “bulles” par exemple — et leurs divers avatars au fil du temps. L’auteur s’y fait brillant et incisif et ce, dans un appel à la forêt pour sauver nos contemporains bardés d’agendas électroniques et de sushis.
Parfois, les textes sont plus courts, illustratifs, faits pour le mot d’esprit même si chaque fois l’auteur sait dénicher ce qui pèche dans la postmodernité. A la gare d’Avignon TGV par exemple, sans odeurs, sans rumeurs et où les arbres sur le parking refusent de pousser.
Bref, pour celles et ceux qui le connaissent, c’est du Laborde dans le texte. La vie gambade même lorsqu’il s’agit d’attendre un covoiturage. Il y a aussi quelques chansons avec “la java des costauds du bec” — entendez les piverts, il y a des rues, des rues, des rues et aussi des paysages à ne pas manquer : entre autres “le bosse douce d’Ousse” là où l’auteur pédale “dans un bain de mousse” mais jamais dans la choucroute.
Choses vues, lues, entendues et vécues sont autant de motifs que ne peuvent que saluer les bons entendeurs d’une écriture savoureuse et dont les grelots tintinnabulent mais sans jamais chérir la moindre nostalgie. Peuvent, en dépit du Covid, s’y espérer des noces à venir, des tours de France et des matchs de Rugby, sport que l’auteur prend néanmoins pour plus intelligent qu’il ne l’est vraiment.
Jean-Paul Gavard-Perret, lelitteraire.com
Bonheur, roman, éd. Cairn, 2021

Laborde se pose avec « Bonheur » à Ossun
Christian Laborde, plus que jamais poète dans ce texte court, encense les réalités terriennes et célèbre le Plateau de Ger et les Pyrénées.
Avec Laborde, la poésie roule sous les cailloux, l’air vif des Pyrénées et la rotule douloureuse du cycliste. Le narrateur, endolori par la mort de sa mère, achète une belle bâtisse à Ossun. La poussière des planchers chatouille sa curiosité, une chambre close l’intrigue, celle d’une jeune fille morte à 17 ans.
Il remonte l’histoire des anciens propriétaires, ces Dembarrère qui, comme tant d’Ossunois, sont allés chercher fortune au Venezuela. Il farfouille, sans en faire une obsession. Se laisse absorber par cette maison vite aimée, ce Plateau de Ger qu’il apprivoise sur sa Singer.
Bonheur, c’est exactement le sentiment que suscite ce texte, publié, en feuilleton l’an dernier dans « La Nouvelle République des Pyrénées ». Bonheur et délectation. Celle des plaisirs simples que Laborde décline, à travers ses œuvres : le vélo(il est l’auteur d’un « Dictionnaire amoureux du Tour de France »), le blues, la Gascogne, la nature, dont Nougaro disait qu’il parle avec « une langue de couleurs ». Et les odeurs brutes de la campagne, quand s’équilibrent les forces animales et humaines, qu’il craint quand elle se laisse happer par la démesure des hommes…
Isabelle de Montvert-Chaussy, Sud-Ouest Dimanche
Poulidor by Laborde, éditions de Mareuil, 2020
Darrigade, éd. Du Rocher, 2020.

André Darrigade
« Je suis de l’Adour, de Narrosse, de Dax, des chemins bordés de haies, des clairières et des bosquets, du soleil généreux, de la pluie, des bêtes paisibles, et d’une métairie. Et je voulais aider mes parents qui travaillaient la terre d’un autre. Comment les aider : en étant à mon tour métayer ? Non. Il me fallait partir et réussir. Comment réussit-on, quand on est Landais et fils de métayer ? On devient torero ou champion cycliste.Je m’appelle André Darrigade et j’ai pris le vélo par les cornes ».
Christian Laborde écrit Darrigade, et l’on entend le roman du vélo, l’éloge des Landes et du gascon, l’épopée du Tour de France. Darrigade est une ode à des instants précieux, à des hommes de qualité qui sprintent vers la gloire, à cette langue qui s’envole sur les routes de Chalosse, et dans les cols Pyrénéens. Christian Laborde écrit Darrigade, comme l’immense poète gascon Bernard Manciet écrivit Per el Yiyo (1), un hommage vivant et vibrant à un rouleur, un sprinteur, un coureur au swing unique, exceptionnel, comme celui chanté par un chœur antique, au torero El Yiyo, né à Bordeaux et tué par le taureau Burlero, dans les arènes de Colmenar Viejo en Espagne. Dédé-de-Dax roule, il roule comme l’orchestre de Duke Ellington, sérieux et fou à la fois, ses envolées sur les circuits et les routes du Tour sonnent comme les solos de Paul Gonsalves.
André Darrigade est né en Chalosse, dans les Landes, on le surnomme Dédé-de-Dax, une terre où l’on parle la langue des Gaves et des Pins, une langue qui roule comme l’Adour. André Darrigade en jaune et en vert dans le Tour de France, c’est pour bientôt. En attendant : en 1939, il monte sur son premier vélo, rouge – le rouge des joueurs de pelote et des écarteurs, le rouge des bérets des bandas –, et André, couché sur son vélo rouge, est le plus grand champion de tous les temps. Les années défilent, la guerre, l’occupation et le Tour suspendu, jusqu’à cette année décisive, 1947, où pour Dédé-de-Dax, tout bascule. Les premières courses et une première licence : Débutant. Les Grands Prix se suivent et il les remporte tous. Un champion est né, une étoile file vers la gloire, le Tour, et les cols des Pyrénées. Il faut pour les grimper du souffle, du style, de l’élégance et du swing, celui des grands sorciers du vélo – Robic, Kübler, Coppi –, et le blond Landais a plus d’un tour dans ses jambes et ses bras. Car il en faut des jambes et des bras pour remporter 22 étapes du Tour de 1953 à 1966, pour devenir champion du monde et de France, s’imposer dans les Six jours de Paris, pour rouler, rouler encore, rouler avec style, comme Christian Laborde, écrivain affûté et à l’affût, écrit son épopée. Il faut avoir les reins d’un écarteur Landais, les jambes d’un marathonien, le souffle d’un alpiniste, et l’œil d’un aigle. Il faut avoir de la tenue, du cœur, et placer Jacques Anquetil sur le plus haut sommet de l’amitié, comme sur celui du Tour.
« André Darrigade est vaillant, résistant, puissant, adroit. André Darrigade supporte le mauvais temps, la canicule et la douleur. André Darrigade est un fabuleux sprinteur et un increvable bouffeur de vent ».
Christian Laborde écrit là, une admirable odyssée, un magnifique portrait d’un coureur hors norme, où l’on croise Robic (2) – Il a rendu aux foules le goût de l’épopée – Raphaël Geminiani –, Loustalas l’écarteur – Loustalas, long et lent, tout de blanc vêtu, pareil au héros de l’Écarteur, le roman lumineux d’Emmanuel Delbousquet –, Roger Lapébie, Fausto Coppi, Louison Bobet, mais aussi Yvette Horner qui faisait valser les maillots sur le Tour et chavirer le cœur des français, et Françoise, Françoise qui deviendra son épouse – Elle est si jeune, Françoise, et tout est si merveilleux, si fort, si exaltant… –, et enfin la montagne. Les montagnes, ces juges de paix aux cols de neige et de pierres, où tout se joue, se révèle, où l’on perd les pédales et où l’on gagne des maillots. Darrigade est le grand roman d’une époque, les Trente glorieuses, le grand roman du vélo, cet art de l’éclair, de l’éclat, que pratiquent des forçats (3) et des dieux. Christian Laborde signe là, le plus touchant, le plus précis, le plus enchanté, le plus admiratif de ses livres, de ses éclairs romanesques et historiques. Un livre qui se lit à voix haute, qui se chante, comme un scat qu’épouserait le gascon, un livre qui swingue comme Claude Nougaro (4) et Dédé-de-Dax sur son vélo à Zandvoort, les Pays-Bas, le circuit, les dunes, la mer, le vent que nul ne gouverne, même les rois. Dédé-de-Dax était de ces rois, qui ont enchanté le Tour de France en gouvernant les cœurs, les vents et les tempêtes.
Philippe Chauché La Cause littéraire
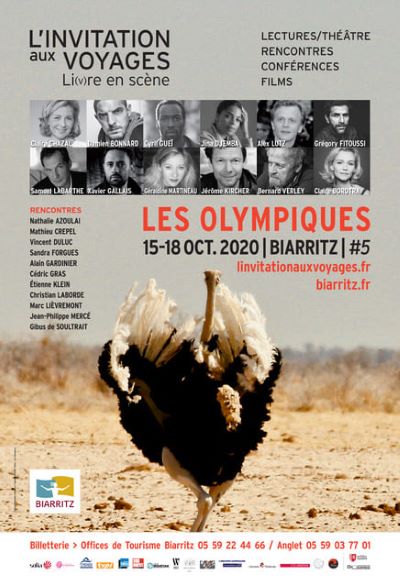
Le Tour de France, éd. du Rocher, 2019.

Tina, roman, éd. du Rocher, 2018.

La belle écriture épurée de Christian Laborde
Un roman de Christian Laborde est toujours attendu avec impatience. Car ses lecteurs savent bien que, jamais, il ne laissera insensible. Christian Laborde, poète avant tout, musicien des mots, est toujours là où on ne l’attend pas. Là, avec les amours torrides entre un professeur et l’une de ses jeunes élèves ; ici, défenseur de lance Armstrong ; un peu plus loin biographe de Renaud ; et, toujours, ami et laudateur (à juste titre) de l’immense Claude Nougaro ; puis au côté du champion cycliste Robic…Insaisissable Christian…
Son personnage, Léontine, dite Tine, dite Tina, est ici ciselée avec une infinie précision.(« Léontine est le prénom qui figure sur sa carte d’identité, le prénom que prononçait la maîtresse d’école quand elle l’envoyait au tableau », confie l’auteur. « Tine, c’est le diminutif que lui donne sa famille, notamment sa grand-mère. Et Tina, c’est le prénom qui lui fabrique Viktor, qu’elle rencontre à Toulouse où elle s’est cachée pour échapper aux tondeuses de l’Epuration. Elle est à la fois Léontine, Tine, et Tina, insaisissable. ») Sa rousse chevelure(qui est peut-être en sursis), nous est décrite par le menu ; ses relations avec le glacial et assez répugnant lieutenant allemand Karl Shäfer, également. Ce bon ami d’Outre-Rhin vivait dans une chambre de la maison de la mère de Tina, réquisitionnée par l’envahisseur. Shäfer aime la poésie en général et Verlaine en particulier(c’est incroyable comme les zélés membres de l’armée allemande et les nazis ont aimé nos poètes !). Il parvient à séduire Léontine et à la glisser dans son lit.(L’Allemand sait être envahissant et faire preuve d’autorité.) La pauvre le paiera chèrement et abusivement : des résistants de la dernière heure la poursuivront et voudront réduire à néant sa rutilante et moussue chevelure. Grâce notamment à son ami Gustin(que l’on considère comme l’idiot du village), Tine parviendra à fuir. Elle se sauvera à Toulouse, sera protéger par des religieuses(elle aura une sensuelle histoire d’amour avec l’une d’elles, sœur Cécile, travaillera dans une boulangerie-pâtisserie, croisera Viktor, un jeune poète apatride, résistant, et vivra avec lui des folles amours flamboyantes et subreptices. Lorsqu’on lui demande comment lui est venu l’idée de ce livre, l’écrivain de Pau, répond : « Un jour où je mettais un peu d’ordre dans les livres, dans les piles de livres – je suis un peu…labordélique !-, je suis tombé sur Au rendez-vous allemand, le recueil de poèmes de Paul Eluard, je l’ai ouvert et j’ai relu le poème qui commence ainsi : « Comprenne qui voudra/Moi mon remords ce fut/La malheureuse qui resta/Sur le pavé/la victime raisonnable/ A la robe déchirée »…Eluard évoque une de ces femmes tondues à l’Epuration…Et j’ai eu envie de lui donner un visage…Un visage et un prénom : elle s’appelle désormais Tina. »Christian Laborde mène son court roman tambour battant pour nous donner à lire une manière de long poème en prose. Du grand art. Vivement conseillé.
Philippe Lacoche
Robic 47, éd. du Rocher, 2017.
La Cause des vaches, éd. du Rocher, 2016.


Pamphlet
Et si les animaux d’élevage étaient devenus une cause culturelle à défendre ? Des voix s’élèvent pour dénoncer leur réduction en « machine à lait »au service d’une économie devenue folle.
On aurait tort de laisser la question des vaches, et plus généralement la question animale, aux hurluberlus de l’antispécisme, ce courant de pensée qui entend conférer à l’animal un statut similaire à celui de l’être humain et qui estime que distinguer entre un homme et un animal est faire preuve de racisme. La conception que l’on se fait de l’animal a, certes, évolué depuis Descartes, qui ne voyait en lui qu’un automate( « l’animal-machine ») dont les cris, lorsqu’on le torturait, n’étaient que la conséquence de dysfonctionnements dans les rouages et non l’expression d’une souffrance.
Mais à cet extrême répond aujourd’hui un autre extrême, qui propose de traiter les animaux à l’égal des humains et de leur conférer des droits qui empêcheraient les hommes de les élever et de les tuer. Comme le dit Chantal Delsol, « il y a là un emballement vertigineux et déréglé de l’indifférenciation à l’œuvre dans la postmodernité ». Toute distinction(entre les cultures, les sexes, désormais entre les vivants) devient discrimination qu’il faut combattre.
Pour autant, la manière dont sont traités les animaux d’élevage dans notre société suscite de plus en plus de réactions légitimement scandalisées.
L’écrivain Christian Laborde publie ainsi un petit pamphlet contre l’agrobusiness, lequel est également un poème exalté célébrant ce paisible animal, ô combien lié aux paysages de notre pays et, partant, à son identité profonde. Dans le viseur du pamphlétaire : la fameuse ferme-usine des 1000 vaches, en Picardie. Selon le témoignage d’un ancien salarié paru l’année dernière sur le site Reporterre, les bovins y vivent dans des conditions épouvantables. Les vaches ne voient jamais le soleil ni les prés, elles sont sales et malades, souffrent et meurent en grand nombre.
A rebours de cette vision d’apocalypse, Christian Laborde se souvient des vaches pyrénéennes de son enfance, qui avaient toutes un nom : Aubine, Cardine, Piguéte, Mascarine, Paloume, Poulide, Aricade….Il se souvient des étables à taille humaine où virevoltaient les hirondelles et où les bêtes étaient correctement soignées par les fermiers, du curé qui bénissaient le troupeau en gascon à grand renfort de signes de croix. Il rappelle que le jour où elles regagnent les prés, après l’hiver passé à l’étable, les vaches dansent : « [Elles] meuglent, certaines levant la tête, d’autres la maintenant baissée[…].Puis, l’une d’elles, s’élance, d’un bond, les pattes avant griffant l’air vif. Lorsqu’elles touchent de nouveau le sol, ce sont celles de derrière qui à leur tour se soulèvent[…] et toutes ces vaches, et toutes ces bêtes que l’on croyait balourdes font montre, dans la lumière et le vent retrouvés, de tout leur talent, de toute leur grâce », écrit celui qui n’oublie pas de rendre hommage à Saint François d’Assise, le magnifique illuminé qui parlait aux oiseaux.
C’est cette même danse des vaches, découverte dans un documentaire diffusé sur Arte, qui a convaincu le philosophe Alain Finkielkraut de faire figurer une tête de vache sur son épée d’académicien. « Remonté contre l’élevage intensif, je ne me résigne pas à la fermeture des fermes », déclarait-il peu avant sa réception à l’Académie française, en janvier dernier.
C’est bien en effet dans l’élevage intensif que réside le problème. Un mode de production dans lequel il revient désormais trop cher de soigner correctement ses bêtes si l’on veut rester compétitif. Telle est la triste réalité d’un monde qui n’accepte plus aucune contrainte autre que celle de l’économie, à laquelle tout doit être soumis, et qui est prêt à sacrifier pour elle jusqu’à l’âme du pays.
Olivier Maulin Valeurs Actuelles, 12 mai 2016
Christian Laborde
De Claude Nougaro, son ami, son modèle, auquel il a consacré des livres filiaux et dont il transmet la bonne parole de ville en ville(il exaltera « l’Homme aux semelles de swing » au Festival d’Avignon, du 7 au 30 juillet), l’intranquille et réfractaire Christian Laborde a hérité de l’art de jongler avec les mots, la fibre jazzy, le physique de boxeur et l’accent tonique du Sud-Ouest. Même quand il râle, fulmine et part en guerre, on dirait qu’il chante, danse et s’esclaffe. Cette fois, le défenseur des ours des Pyrénées et des taureaux que la corrida martyrise se bat « pour le droit des vaches à disposer de l’herbe » et contre la ferme-usine picarde des mille vaches, ce camp de torture et de mort, ce « stalag de béton et de fer ». Avec une rage voltairienne, il vitupère « les Vanderdendur de l’agrobusiness »(allusion à l’esclavagiste de « Candide »), en appellent à tous ceux qui ont célébré la vache(de la peintre Rosa Bonheur au poète Norge, de saint François d’Assise à Roger Vitrac), se remémore les prairies laitières de son enfance, sur les bords de l’Adour, et les rues d’Aureilhan, où les belles ruminantes avaient la priorité. Comme toujours, Christian Laborde, balançant à chaque page ses « jabs syllabiques », excelle dans l’excès. La preuve avec « la Cause des vaches »(Rocher, 15 euros), à la fois pamphlet contre la dictature de la « désanimalisation » et chant d’amour à des bêtes qu’il compare à des danseuses étoiles, des coureurs cyclistes, des rockeuses, de merveilleux nuages et des messagères des dieux. Sûr que Nougaro en aurait fait une chanson punchy.
Jérôme Garcin, L’Obs, 25 mai 2016
Les vaches sous la Coupole

Le jeudi 30 novembre 2017 L’Académie française reçoit sous la Coupole, dans une séance publique annuelle présidée par M. Jean-Christophe Rufin, les lauréats qu’elle a distingués au cours de l’année. Monsieur Michael Edwards, Directeur en exercice, parle ainsi de la Cause des vaches, essai auquel L’Académie française décerne le Prix Jacques_Lacroix :« Il s’agit d’un essai vigoureux, voire pamphlétaire, pour dénoncer le calvaire que nous infligeons (en particulier) aux vaches, à l’heure où l’animal cesse d’être un animal pour ne devenir qu’une machine à lait ou à viande. Un magnifique plaidoyer »
« Un réel souffle poétique », Michel Houellebecq
Le sérieux bienveillant des platanes, roman, éd. Du Rocher 2016

Le troubadour de l’Adour
Ce qui frappe chez Christian Laborde, troubadour de l’Adour, swingueur intempestif qui a su faire à l’occasion danser la langue avec ses compatriotes et amis du Sud-Ouest comme Nougaro ou le jazzman Bernard Lubat, c’est une forme de constance. Il est toujours en guerre, depuis presque trente ans, contre l’ennemi le plus dangereux qui soit: le désenchantement du monde. Il a ainsi passé les trois dernières décennies à vider ses chargeurs sur la grisaille clinquante d’une société qui a commencé à installer son cauchemar mal climatisé dans les fatidiques années 80. A l’époque, qui est aussi celle où il a collaboré à L’Idiot international, il pouvait paraître alarmiste. Aujourd’hui il est devenu le greffier lyrique de nos renoncements et nos amnésies. Attention, si Laborde regrette le monde d’avant, il n’est pas pour autant nostalgique : il y a trop d’énergie, d’électricité soyeuse dans ses romans, ses essais, ses nouvelles, ses poèmes. Il suffit de lire ses deux derniers livres pour s’en convaincre : La cause des vaches, un pamphlet qui a beaucoup fait parler de lui juste avant l’été et un roman qui sort pour la rentrée littéraire, Le sérieux bienveillant des platanes, dont le titre emprunté à Jean-Claude Pirotte, autre paysagiste vagabond disparu il y a deux ans, nous indique si besoin était que l’on est en bonne compagnie.
De quoi avons-nous fait le deuil ou plutôt de quoi doit-on refuser de faire le deuil, voilà la question qui forme la colonne vertébrale de cette œuvre qui a célébré et qui célèbre, dans le désordre, les femmes callipyges, les ours, les paysages, les vaches, les arbres ou encore le courage des coureurs cyclistes, les idoles de Laborde qui à l’instar d’Antoine Blondin, connaît les plaisirs des caravanes du Tour de France où le dépassement héroïque de soi a pour décor les villages du vieux pays au lieu des remparts de Troie mais reste le même depuis plus de deux mille ans.
Laborde est entré en littérature par un scandale mais ce qui est important, sans le rechercher. C’était en 1987. Son premier roman, L’Os de Dionysos, était publié par un petit éditeur du Sud-Ouest et a été interdit, presque aussitôt, par les tribunaux avec notamment, dans les attendus du jugement, une étonnante « incitation au paganisme. » Laborde, parce qu’il était aussi professeur dans un collège religieux, était devenu un railleur subversif, un pornographe vicieux et on imagine sans peine ce que durent être les conspirations mauriaciennes pour étouffer ce livre. Heureusement, en 1989, le titre était repris par Régine Deforges et connaissait un succès qui mit Laborde à l’abri. L’auteur se demande encore aujourd’hui s’il était l’ultime victime d’une censure old school de type pompidolien ou la première de ce néopuritanisme qui laisse la pornographie s’étaler sur Internet mais s’interroge gravement pour savoir s’il serait aujourd’hui opportun de publier Lolita.
Laborde était tout entier dans ce premier roman, c’est à dire un païen sensuel, ce qui prouve que les juges avaient vu juste. Comme le dieu qu’il prenait pour intercesseur, il montrait son goût pour la danse, la démesure, le plaisir. Son héros, professeur de français, luttait contre la bêtise et la médiocrité de ses collègues et de ses supérieurs. Il avait deux armes à sa disposition, les mêmes qu’il utilise encore aujourd’hui : l’écriture et la femme. Dans L’os de Dionysos, la femme s’appelait Laure d’Astarac. A la femme, il devait d’oublier son quotidien, à l’écriture d’échapper à un destin de mort vivant. Dans Le sérieux bienveillant des platanes qui raconte l’histoire d’un poète marginal, un peu rocker, un peu voleur revenant dans son village d’enfance en compagnie de Joy, une prostituée, pour aller enterrer son grand-père, un ancien de la Légion étrangère, on retrouve la même oscillation entre la chronique acide d’une société enlaidie et la joie panique, totale, d’être au monde et de le dire. Dans L’Os de Dionysos, la célébration du cul de Laure succédait ainsi au portrait d’une principale frustrée tandis que dans Le sérieux bienveillant des platanes, ce sont les seins de Joy qui font oublier à l’enterrement la présence d’un père créatif, ex-soixante-huitard, chainon volontairement manquant de la transmission entre le grand-père et le petit fils.
Ce qu’on ne pardonne pas aux écrivains dont on condamne les livres, depuis Flaubert et Céline, c’est le style parce que le style, loin de toute codification porno, rend la sensualité vraie des corps dans l’amour comme l’explique Tom, le héros des Platanes : « Seul le frémissement des seins sous un chemisier peut rivaliser avec celui du feuillage quand le vent d’été s’égare dans les branches des arbres. C’est un truc que je sais et ne lis nulle part. Y a pas le corps dans les livres d’aujourd’hui bien que leurs auteurs prétendent le contraire. Ca exhibe, ça affiche, ça filme de près, mais le corps, ils le ratent, ils passent à côté, parce que le merveilleux, c’est pas leur truc. Ce sont des huissiers, des adeptes de l’inventaire. Et les poètes, les mecs qui marchent à l’imagination, ils les dénoncent aux flics. »
Il est vain d’essayer de classer politiquement Laborde. On se souvient de l’avoir croisé en 2002, dans les parages des soutiens à la candidature de Jean-Pierre Chevènement. Cela n’avait pas été une mince affaire de convaincre cet Occitan amoureux de son terroir de soutenir le candidat du jacobinisme retrouvé. Mais il y avait chez Chevènement une manière d’aimer la France d’avant et chez Laborde de ne pas concevoir son régionalisme autrement que comme un universalisme qui avait permis une synthèse.
On retrouve cette synthèse dans La cause des vaches où il nous parle de la manière concentrationnaire dont fonctionnent les néo-fermes de l’agrobusiness et où son indignation flamboyante s’appuie sur une vraie documentation. Déjà, il s’était fait connaître pour son opposition à la corrida et au tunnel du Somport qui allait mettre en danger nos amis les ours. Et pourtant il n’y a rien d’un végan antispéciste chez Laborde. Il n’aime pas les vaches comme des égales, il aime les vaches comme il aime les platanes qui disparaissent le long des routes au nom du principe de précaution pour les automobilistes : parce que le monde est plus beau avec des vaches heureuses et des platanes ombreux que sans : « Quand je te parle des vaches, je te parle de toi, également de lenteur. C’est pas un truc de vieux, la lenteur. La lenteur, c’est un truc de gourmand. II s’agit d’écouter, de regarder, de savourer, de méditer, comme le faisaient les vaches. Je les ai vues faire, les vaches. Elles n’accéléraient jamais. Le sabot sur le champignon, jamais. »
Jérôme Leroy, Causeur 11 septembre 2016
(1) : Danse avec les ours, Régine Deforges, 1992 ; Corrida, basta !, Robert Laffont, 2009.
Les premiers seront les derniers
Un journaliste professionnel ne devrait pas parler de ce livre : trop tard, il ne figure plus dans « l’actu ». Le Sérieux bienveillant des platanes, de Christian Laborde fut publié le 18 août 2016, autant dire il y a un million d’années. Ce n’est pas faire injure à son auteur que d’affirmer que ce livre ne fut pas l’événement de la rentrée. Les libraires l’ont probablement déjà remplacé sur leurs étals par un des romans à paraître la semaine prochaine, ceux de Pennac, Rouart ou Lambron. Il n’a pas obtenu de prix littéraire, il n’a pas fait scandale, il n’est passur la liste des best-sellers. Pourtant ce petit roman buissonnier vous offre une parenthèse enchantée si, comme toute personne saine d’esprit, vous avez envie d’échapper quelques instants à votre famille entre Noël et le Nouvel An…
Tom, un rockeur gascon, emmène Joy, une princesse prostituée, à l’enterrement de son grand-père. Ils traversent le sud-ouest de la France en Volkswagen. Avec leurs amis, ils volent des verre en cristal pour y verser du vin tannique, tout en se dopant à la « poule au pot belge ». Les voilà partis dans une virée anarchiste et écoutant Wasting my Young Years de London Grammar, une fuite qui rappelle les exodes ruraux d’Olivier Maulin, vers un deuil qui révèlera des secrets datant de la guerre…
Christian Laborde n’est pas n’importe qui : le dernier écrivain censuré en France, pour « trouble illicite, incitation au désordre et à la moquerie, pornographie,[…] danger pour la jeunesse en pleine formation physique et morale » selon le jugement du tribunal de Tarbes en 1987. Une décoration plus prestigieuse que la Légion d’honneur. Il n’écrit pas, il scande. Cet exégète de Claude Nougaro rythme ses phrases comme le troubadour toulousain. Le lisant, on entend son accent syncopé. Laborde, c’est un rappeur avec du vocabulaire, un slameur qui aurait lu Céline (pas Dion, l’autre). Une racaille rocailleuse et rabelaisienne. Parfois il en fait trop ? Objection, votre honneur : il faut trop de tout, car comme disait Ted Nugent : « Si c’est trop fort, c’est que vous êtes trop vieux. » Je peux vous assurer que cette odyssée occitane respire la joie et la liberté. En plus, c’est vrai qu’ils ont un sérieux bienveillant, les platanes, sauf quand on fonce dedans sans airbags. En conclusion, n’oublions pas le principal : personne n’a lu L’Ecume des jours à sa sortie. Ne prenons pas la vitesse de rotation des offices pour un critère de qualité éditoriale. Le succès est à la littérature ce que les sondages sont à l’élection.
Frédéric Beigbeder Le Figaro magazine, 31 décembre 2016
Madame Richardson et autres nouvelles suivi de Quai des bribes, éd. Robert Laffont, 2015.

L’encre de Laborde
On l’avait laissé en 2012 reluquant les shorts – ces « copeaux d’Éros » – de Diane et de ses affriolantes copines (Diane et autres stories en short, Robert Laffont). Après un détour par le Tour de France et un superbe Parcours du cœur battant dans le sillage de son ami Claude Nougaro, oyez ! oyez ! pas le temps de reprendre son souffle car revoilà Christian Laborde, percutant nouvelliste, qui vient nous shooter aux héroïnes de Madame Richardson et autres nouvelles.
Douze textes qui filent à toute berzingue, sans temps mort mais trompettes oui, celles des cuivres de Duke Ellington par exemple, qu’on entend, avec Camélia Jordana, Charles Trenet, Cat Stevens, Vanessa Paradis, et bien d’autres encore, dans la longue playlist donnée en fin de recueil et qui ressemble à la BO de ce livre à sketches, comme d’autres ont fait des films.
Aucun doute d’ailleurs, le cinéma est bien l’une des grandes sources où puise l’encre de Christian Laborde, celui de Lautner peut-être, de Louis Malle sûrement. Sur l’écran noir de ses pages blanches, se déroule la pellicule de quelques troublants courts-métrages : l’éponyme « Madame Richardson » qui prend un amant pour se délivrer d’un mari ennuyeux à mourir, « L’Espagnol » que les hommes regardent de travers au village et qui se tape leurs femmes pour se venger, « La Bamba » et sa cavale d’amour éperdu… On retrouve aussi avec plaisir toute la veine surréaliste de Christian Laborde, lorsqu’il entonne Le blues du cartable de Constance Beaupré, la prof de français sexy du lycée Alexandre-Dumas, ou qu’il nous plonge surtout dans le merveilleux bain d’« Aquarium »…
Mais il faut avouer un faible pour Trois saisons, cette longue valse noire qui commence avec la nostalgie sacrée de Robert Charlebois quand la mère meurt (« Les cantiques, ça vaut pas Je reviendrai à Montréal »), se poursuit dans la douceur tragique de la belle Albane (« et tout ce que son souffle charriait d’enfance, de neige et de nuit, de désastre et d’aube, était à moi »), et s’achève dans l’impossible passion de cours particuliers de français qui dérapent (« Sa bouche, c’était juin. Juin, qui m’avait perdu de vue, venait à ma rencontre »).
Autant d’histoires qu’on traverse d’une traite, fussent-elles parfois empreintes d’une certaine facilité adolescente dans l’écriture, que vient pourtant magnifier, pour les plus réussies, d’éblouissantes trouées poétiques. Rien de plus libre alors, de plus cru parfois, de plus beau en un mot pour dire la beauté de ces héroïnes qui aiment leur corps, le désir qu’il suscite, et la jouissance qu’il procure.
À noter que les douze nouvelles sont suivies de Quai des bribes, qui réunit des Mots éparpillés sur le net et dans les journaux, de la victoire de Carlos Sastre au Tour de France à la mort de Lou Reed. Soit pas moins de 52 « texticules », pour reprendre le mot de Raymond Queneau, où l’on retrouve avec délectation la plume du pamphlétaire et son jeu favori de sacre et de massacre. D’un côté, le concert du pivert de l’avenue des Lauriers, digne élève d’un Bernard Lubat ; le voleur des culottes des femmes d’Adast, cet « amant des plis », ce « lecteur d’étoffes » ; la pluie, miraculeuse, qui « transforme nos toits de tuiles ou d’ardoises en xylophone » ; Laurent Fignon… De l’autre, l’arrogance des 4×4 des « cardiologues incultes » ; les supporters du Qatar-Saint-Germain…Un plaisir roboratif.
Frédéric Aribit, La cause littéraire
A chacun son Tour, chroniques du Tour de France, éd. Robert Laffont 2015
L’épopée du Blaireau, éd. de Mareuil, 2015

Claude Nougaro, le parcours du coeur battant, éd. Hors-Collection, 2014.

Tour de France, nostalgie, éd. Hors-Collection, 2012, Prix Louis Nucéra 2013.

Diane et autres stories en short, éd. Robert Laffont, 2012.



Des tranches de fille
Christian Laborde fantasme tellement sur les nanas en short qu’il en fait 17 portraits alertes, fuselés, fins et dorés. Je ne comprends pas son fétichisme du short: je préfère les filles en minijupe ( ne serait-ce que pour des raisons pratiques) ou les filles en shot(plutôt de vodka au caramel). Pour tant je l’avoue: comme l’actrice Marie-Josée Croze, j’ai dévoré ses textes la bave aux lèvres.

Laborde est un amoureux insatiable(un « perv », dit une de ses héroïnes), il me rappelle Charles Denner dans « L’homme qui aimait les femmes » quand il tape à la machine et articule ceci fiévreusement: » Elles sont des milliers, tous les jours, à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? »
Connu de nos services de police pour érotomanie publique et manifeste depuis l’interdiction de « L’os de Dionysos » en 1987, Christian Laborde est un dangereux obsédé textuel, béarnais de souche, surnommé « le D’Artagnan des mots » par la revue nantaise « Chiendents ». » Diane et autres stories en short » n’est pas un recueil de nouvelles mais un catalogue de femmes: des tranches de fille. Il y a Irène, Anne, Diane(celle du titre), Florence, Mathilde draguée » à Auchan, au rayon frais », Hélène, Rita, Rebecca. Surtout Rebecca, qui lui inspire une rime simple: » le paradis, ici-bas, c’est la culotte de Rebecca. »(Je parie que cette fraîcheur aurait amusé Pierre de Reigner, ainsi que toutes les rimes en -a de la page 116). Les poètes ont besoin des muses, en short ou pas. Laborde fait jazzer la langue comme son ami Nougaro, sur lequel il a écrit trois livres; parfois il pousse le vice jusqu’à bousculer l’orthographe: » Je denouerai le ceinture de son peignoir »(page 21, c’est moi qui souligne). La beauté féminine le trouble tant qu’il en changerait presque le sexe des mots.Laborde a milité contre la corrida et pour les ours des Pyrénées. Cette fois, son engagement est quasi religieux. Le short gris de la demoiselle qui lit « Hantises » de Joyce Carol oates à la terrasse du Gotiko Bar peut être considéré comme une relique sacrée. Son livre est un manifeste primesautier et libidineux, comme » Les jambes d’Emilienne ne mènent à rien » d’Alain Bonnand. Que devient Alain Bonnand? Il se cache, il a disparu. Peut-être s’est-il lassé de n’être pas reconnu à sa juste valeur. Un peu comme Christian Laborde, il est victime de l’indifférence des médiocres. Il n’y a pas qu’en Syrie que le silence peut tuer.
Fréderic Beigbeder Le Figaro Magazine.
Le soleil m’a oublié, éd. Robert Laffont, 2010.

Un roman uppercut
Ecrivain talentueux, Christian Laborde a plus d’une corde à son arc. Biographe de Nougaro ( « Mon seul chanteur de blues », éditions La Martinière, 2005) et de Renaud (« Renaud », Flammarion, 2008), poète (« Congo », éditions d’Utovie, 1987), pamphlétaire, ennemi juré de la corrida (« Corrida basta », Robert Laffont), essayiste, fou de vélo ( « Le Roi Miguel », Stock 1995, « Dictionnaire amoureux du Tour de France », Plon, 2007), et surtout, surtout, bouillonnant romancier de haut vol ( il faut lire à tout prix son génial « L’Os de Dionysos », Pauvert, 1999 , mais aussi « Soror », Fayard ,2003) En cette rentrée littéraire, le voici de retour avec un roman uppercut, plein de violence, de suspens, d’amour, de sensualité, de grâce et de folie : « Le soleil m’a oublié ».
Il nous invite à suivre les pérégrinations de Marcus, un jeune garçon à la fois bon, généreux. Et violent. C’est à cause de cette violence qu’il a été contraint de quitter le lycée. Pour la canaliser, il s’adonne à la boxe. Dans cet art, il s’exprime avec talent. Avec passion. Pour gagner de l’argent, il est veilleur de nuit dans un hôtel de passe où ses qualités de puncheur font merveille, au grand désespoir de costauds abrutis d’alcool ou de maquereaux qui se croient tout permis. L’hôtel appartient à Vico, comme le club de boxe dans lequel Marcus s’entraîne. Parfois, après avoir bu, il part cambrioler quelques maisons bourgeoises en compagnie de copains. Un soir, au cours d’un entraînement, il croise Roxane, la femme de Vico. Coup de foudre. Passion immédiate. Il ne peut l’oublier. Il brûle d’amour et de désir. Mais comment l’aborder ? Comme la retrouver ? Vico lui tendra involontairement une perche en lui demandant de venir réparer l’ordinateur de Roxane. Elle finira par lui proposer un rendez-vous. Marcus n’a jamais aimé avec autant d’intensité.
Mais on s’en doute, la belle histoire d’amour se terminera très mal. Car Vico a appris l’aventure de sa femme avec le très jeune homme. Le compte sera réglé à coups de nerf de bœuf…
Le court roman est mené tambour battant. Pas un gramme de graisse, pas un mot de trop dans ce texte étincelant, émouvant, tout en muscles comme un blues de Jimmy Reed. Philippe Lacoche, Le Courrier picard, mardi 31 août 2010
Le soleil m’a oublié: avec les collégiens de Pontacq



Le Tour de France dans les Pyrénées., De 1910 à Lance Armstrong, éd. Le Cherche-midi, 2010.
Corrida, basta !, éd. Robert Laffont, 2009.

Le bouquin qui manquait
« Le livre est un pur régal! C’est le bouquin qui manquait pour détruire définitivement cette race de crevures que sont les toreros! Olé » Gloire à tous ces taureaux qui ont vengé, vengent et vengeront leurs frères assassinés dans des arènes pour une mini flaque au fond du string d’une poignée de connes, pour un peu de tension dans le slip kangourou des connards qui les sautent! » Christian Laborde, dans un style d’une rare sauvagerie, comme j’apprécie, dézingue la » chorégraphie charognarde » de la corrida avec un rare bonheur. J’aurais aimé écrire ce livre. Trop tard. » Siné, Siné hebdo, 6 mai 2009
« Christian Laborde pose d’emblée la question de fond : « L’homme est-il encore un homme, un être de culture, un honnête homme quand il écorche, humilie, torture et tue un animal afin que jouisse la plus grande salope que la terre ait jamais portée : la foule ? » Thomas Longué Sud-Ouest
Renaud, biographie, éd. Flammarion, 2008.
Chicken, éd. Gascogne, 2007.
Dictionnaire amoureux du Tour de France, illustrations d’Alain Bouldouyre, éd. Plon, 2007.

Panache
« Christian Laborde n’est pas du genre à sauter une lettre de l’alphabet d’un dictionnaire, surtout lorsqu’ il s’agit de celui du Tour de France. Ce serait sacrilège comme une chaîne qui sauterait une dent d’un pignon. De A comme Abdoujaparov (Djamolidine) à Z comme Zéro (boule à) « , jamais un dictionnaire n’a porté l’adjectif amoureux avec autant de panache.»
Anthony Palou, Le Figaro magazine 2007
Pension Karlipah, éd. Plon jeunesse, 2007.
Champion, éd. Plon, 2006.
« Poète rare, romancier de grand talent et conteur exceptionnel, Christian Laborde cultive sa différence sur les routes escarpées de sa passion: le cyclisme. Il nous entraîne au fil de sa plume sur les traces de Lance Armstrong, septuple vainqueur de la Grande Boucle. Avec un style aussi alerte qu’un sprinter, Christian Laborde contrôle sa course comme un pro pour nous faire retrouver le goût de la passion des héros. »
Pascal Hébert L’Echo Républicain
Percolenteur, éd. du Panama, 2005.
Laborde en vingt-trois textes brefs comme autant de cartes postales venues de Pau où l’auteur de L’Os de Dionysos nourrit son inspiration aux pieds des Pyrénées chères à cet amoureux de la petite reine. Saisons, objets, lieux ou mots servent ici de support à des évocations ciselées qui prennent le grand large. Cela s’appelle Percolenteur et sent le petit noir pris sur un zinc avec cette langueur devenue le luxe des temps modernes. Souvenirs d’enfance ou observations glanées dans les rayons d’un supermarché: Laborde fait son miel de ces petits faits vrais qui en disent beaucoup. A propos d’un village promis à la disparition pour laisser place à un aéroport, il écrit: « A Chaulnes, ceux qui ont une maison sont priés de la vendre. Dans la France qui se construit, il n’y a de place ni pour les morts, ni pour les vivants. » Juste avant la fin de tout, saisir ce qui peut l’être encore. Christian Authier, L’Opinion Indépendante
Mon seul chanteur de blues, éd. de La Martinière, 2005.


Deux enfants du
Sud-Ouest
« Loin de la biographie de pensum, un vif récit de l’amitié entre Claude Nougaro et l’auteur. Malgré la différence d’âge, les deux hommes, quand ils se rencontraient, avaient l’impression d’être des jumeaux qui auraient eu pour parents la poésie et l’insoumission. Le même amour de la langue les réunissait. Ces deux enfants du Sud-Ouest s’entendaient donc à entremêler souplesse, esprit et sens du rythme. Autant de qualités dans cet hommage au poète, plusieurs chansons appartenant à la mémoire d’un peuple. Au grès des souvenirs, le fantôme de Jacques Audiberti, de Jean Cocteau et d’Edith Piaf. C’est émouvant. »
Bernard Morlino Le Figaro littéraire
Fenêtre sur Tour, éd. Bartillat, 2004.
Soror, roman, éd. Fayard, 2003.

Fureur des âmes et horreur du monde
« Christian Laborde reste – il l’était avant Houellebecq et G. Dantec – viscéralement hostile au monde marchand qui envahit, accable, défigure. […] Fureur des âmes et horreur du monde et, par-dessus tout, cette musique des mots, qui joue comme la pluie, calmant ou aiguisant les sensualités. »
Tribune Côte d’Azur 2003
Collector, éd. Bartillat, 2002.
« Christian Laborde n’a jamais laissé indifférent. Ses romans, ses pamphlets, ses poèmes, ses articles percutants lui ont valu d’être à la fois censuré et célébré. Il est toujours resté libre. Collector offre le meilleur de ses textes parus dans la presse. »
Un critique doit être capable d’aimer son contraire. Tenez, un exemple : moi. En tant que parigot tête de veau, victime de la mode et de ses logos, obsédé par l’an 2002 et ses discothèques, je dois pouvoir comprendre Christian Laborde, le « taste-mots » baroque, le troubadour postsurréaliste, le Robin des bois pyrénéen, l’insoumis de la Vallée d’Aspe. Car je suis un lecteur fait de tous les lecteurs et qui les vaut tous et qui vaut n’importe qui !
Désolé, cher Christian, de citer Sartre plutôt qu’André Breton…Dans le marasme actuel, un désobéissant comme vous apporte à notre littérature parisienne un souffle d’air pur. On est en droit d’en avoir marre des quêtes d’identité : Qui suis-je ? Où vais-je ? Tell me whyyyy !? Ce refrain de ma génération ne concerne pas l’amateur de cyclistes glabres et de mammifères poilus. Vous, au moins, savez d’où vous venez et où vous restez : entre Tarbes et Pau, là où ma famille a vu le jour, là d’où vient mon nom imprononçable. Pourquoi est-ce que je ne vous ressemble pas ? Vous parlez le patois qu’on ne m’a pas enseigné, sauf dans mon enfance, l’été, en l’église de Guéthary, chère à Paul-Jean Toulet. Pour moi, la danse des mots, c’est une chanson de Mondino ; vous préférez celles de Nougaro. Nous sommes différents, d’où nos différents.
Je crois pourtant comprendre ce que vous dites de votre accent chantant. Il me semble discerner pourquoi vous luttez : pour une « invention verbale », contre la novlangue technocratique, pour le reblochon, contre le surgelé. Contre ce qui est pour (Bernard Tapie, Loft story, l’école de Brive) et pour ce qui est contre (Jean-Edern Hallier, Khaled Kelkal, Roland Topor) Seriez-vous le José Bové des Lettres ? Je n’ai qu’un goût assez limité pour le régionalisme, ce folklore paranoïaque. Je me fiche d’être basque, béarnais, germanopratin, français ou européen : je suis terrien. Je préfère quand Laborde se saborde pour les « escarmouches vocaliques », quand il « vide son chargeur syllabique », quand il se définit comme « un forgeron des sons », et cite Tzara en exergue : « Il n’y a que deux genres, le poème et le pamphlet ». Collector défend un vocabulaire et des paysages. C’est une écologie du verbe, une lettre aux « mains veuves du vent ». Cher Christian Laborde, ce qui nous rassemble finira par être plus important que ce qui nous sépare. « Telle est la prouesse de la société libérale avancée : avoir rendu la vie impossible à la campagne qui n’en finit pas de se vider et à la ville où l’on n’en finit pas de s’entasser. » Le rat urbain se réconcilie avec le rat rural : l’Idiot avait beau être international, il militait déjà contre la mondialisation ! Tout Parisien tête de chien cache un ex-provincial aux Berluti crottées. J’ai humé vos montagnes, j’ai goûté notre passé, j’ai voyagé sur votre papier volant. Merci Laborde, pour vos cimes décimées et vos causes perdues. Dans le genre excité, vous êtes d’un autre calibre qu’Alain Soral ! Comment aurait conclu Blondin ? Les Basques, on s’y accroche ? Voilà.
Oh ! mais qui donc es-tu, Christian Laborde ?
Né en 1955 à Aureilhan dans les Hautes-Pyrénées, Christian Laborde n’a pas eu envie de monter à la capitale, car il a retenu ces vers de René Guy Cadou : « Pourquoi n’allez-vous pas à Paris ? Mais l’odeur des lys ! Mais l’odeur des lys ! » Il s’est donc lentement « oursifié », jusqu’à devenir l’ermite éructant du plateau de Lannemezan. Son principal titre de gloire restera la censure absurde par le Tribunal de Tarbes de son premier roman, L’Os de Dionysos (1987), pour « trouble illicite, incitation au désordre et à la moquerie, pornographie, abus de mots baroques, danger pour la jeunesse… » Les suivants firent moins de bruit : Indianoak (1995), Flammes (1999) et Gargantaur (2001). C’est que Laborde excelle surtout dans la pièce brève et révoltée (comme l’atteste Collector, mais aussi Aquarium en 1990). Sa prose échevelée s’épanouit aussi dans l’exercice d’admiration : ses odes à Claude Nougaro (L’homme aux semelles de swing), Miguel Indurain ou Charly Gaul (L’Ange qui aimait la pluie) figureront un jour dans l’Anthologie du Lyrisme Universel. Frédéric Beigbeder, Voici, juin 2002
Gargantaur, roman, éd. Fayard, 2001.
Un écrivain qui résiste
Si Christian Laborde gagne à être connu, pareillement, et plus encore sans doute, le lecteur gagne à le connaître.
Tout d’abord, comment ne pas éprouver d’estime pour un homme qui déteste les chasseurs, l’Europe et son Euro, le pouvoir du fric, la flicaille post-moderne, les « élus » gestionnaires, les parcs d’attractions, les e-mails, les banques, Rudolph Diesel, la Modernité, l’énergie atomique, la bourse, les jeux ludo-éducatifs, les 4×4 pour gros cons ?… Et comment ne pas éprouver de sympathie pour un homme qui aime l’Argentine, les femmes, la D.S. « Prestige » vedettedu Salon de l’Auto 1958, l’envol des mouettes, la jolie Clotilde qui se baigne nue dans une rivière, le vent de la pampa, les nuances roses et mauves du ciel, les coquelicots, les eaux jaunes du Paraña qui se joignent à celles de l’Uruguay, les libellules, les vaches qui pleurent, le souvenir d’une péniche sur un chemin de halage un soir d’été?
Gargantaur est un superbe roman et l’on enrage de ne pas bénéficier d’un tel crédit qu’il suffise de le proclamer sans avoir à s’en expliquer. Quoi, à la fin, ma parole ne suffit pas ?…On songe au mot de Pierre Reverdy : « L’évidence paralyse la démonstration ».
Tentons tout de même, le moins pauvrement possible, d’évoquer ce roman…
Nous sommes dans un futur indéterminé mais du train où vont les choses, c’est à dire du train où se défait un monde qui n’était pas sans élégance, il est à craindre que nous nous trouvions dans un futur très proche. A deux doigts du cauchemar entrevu dans Métropolis de Fritz Lang (1927) puis Brazil de Terry Gilliam (1985), un demi siècle plus tard. Sans parler d’Orwell… Au fond, Laborde ne fait qu’accentuer les tendances de la société actuelle, les envisageant dans leurs développements ultimes mais y ajoutant, contrairement au sociologue, la grâce et l’efficacité du romancier en colère. Qu’on imagine des centres villes pour nantis où la vie est aseptisée bien que les effets du nucléaire s’y fassent sentir par la bande (si l’on ose dire !) : sous le regard câlin de la poissonnière, le poissonnier sert ses clientes très vite mais il est vrai qu’il a « quatre mains et deux bites », ceci expliquant la joie des clientes et celle, en vérité d’une autre nature, de la poissonnière. Aux portes de la cité radieuse bourrée de flics, section d’assaut, milice et groupes de combats, on arrive à la zone, lieu de la multitude, terre de métissages où les lascars en colère ne laissent pas mourir le feu : autobus, voitures de pompiers, immeubles, tout brûle à l’image de Gargantaur, complexe à ordures où l’on enfourne frigidaires, porte-avions et autres camelotes qui ressortent en lingots pour fabriquer d’autres frigidaires, de nouveaux porte-avions et infiniment de camelotes.
Orlando, le personnage central du roman, est chauffeur de taxi. Il roule en D.S. « Prestige », lit beaucoup et choisit ses clients. Dans ce monde si laid, et déjà si proche du notre, il survit grâce au rêve d’Argentine où jadis partit un de ses ancêtres. Au triomphe minable de la marchandise, il oppose Buenos Aires, ville mauresque, terre de félicité et eldorado. Les vieilles façades hispaniques contre le yaourt bio et survitaminé de l’imbécile « heureux ». Le livre d’Albert Londres sur les cargos de la ligne Hambourg-Montevideo contre les hyper surfaces. Le sud coloré et odoriférant contre le nord « clean » et dépressif.
Certes, Orlando pratique l’amitié et connaîtra l’amour mais bon, cette passion si bien décrite (Laborde semble savoir aimer les femmes) ne sera pas des plus simples…
On ne peut nier aussi qu’épouvanté par ce qui nous attend, certains passages sont d’une drôlerie absolue et nous arrachent un rire nerveux. Par exemple, dans ce meilleur des mondes, les super-Verts feront arrêter en une nuit et à leur domicile tous les chiens de la ville avant de les gazer : trottoirs propres obligent. Mais l’autorité, qui veut hélas bien faire, clônera de malheureux clébards qui seront génétiquement modifiés pour fabriquer le chien sans anus. Adieu, étrons, mais adieu aussi liberté. Triomphe de la propreté dans les villes moches et froides contre déjections canines dans les villes de rêves où règne encore une humanité dont il faut savoir accepter certains inconvénients. Alors, qui sont les barbares ? On a la propreté qu’on mérite.
A la réflexion, Laborde, révérence gardée, est un lascar des Lettres Françaises quand tant d’autres, dont on fait si grand cas aujourd’hui, n’en sont que les poupées gonflables. Laborde est un romancier de tempérament, qui doit avoir beaucoup d’ennemis, comme il est d’usage pour tout bon écrivain. Il est porteur d’un univers. Davantage révolté que révolutionnaire, anti-conformiste qui ne se soumet pas, il est de la famille des Barbey d’Aurevilly, des Bernanos. Ses petits frères s’appellent Sébastien Lapaque et Jérôme Leroy. Il s’agit, on le voit, d’un gentlemen et ne l’est point qui veut. Bref, comme d’habitude, il faudra cinquante ans pour que les crétins et les jaloux l’admettent, mais en cette détestable époque, Laborde est un de nos rares bons écrivains. Frédéric H. Fajardie
Le petit livre jaune, éd. Mazarine, 2000.
Flammes, roman, éd. Fayard, 1999.

« L’été sur le Plateau, la chaleur étouffante et, dans la ferme Lahitte, le feu. Des feux, des dizaines de feux surgissent à toute heure du jour et de la nuit. N’importe où, une robe dans un tiroir, la huche à pain, le linge sur la corde… Tout brûle. Un feu qui ne s’arrête pas, devenu fou. Un étrange ballet de gendarmes, de journalistes et de gens du coin se déploie sur ce plateau de caillasse et d’argile où le maïs a peu à peu remplacé les landes ; on monte la garde devant la maison. »
Christian Laborde? L’écrivain? J’ai bandé en lisant l’Os de Dionysos, le premier de ses romans. J’ai eu chaud en lisant son dernier: Flammes sorti chez Fayard. Erection pour roman érotique, sudation pour un roman de feu! C’est assez pour conclure: Laborde sait écrire! Son style emporte, aspire et vous rentre dedans. J’aimerais le dire ici mais le puis-je vraiment? J’aimerais même en dire plus. Parler vocabulaire. Dire comment et combien Laborde jongle avec, habite dans et triture les mots: «Panicules», «tonnes», «crémones» et maïs «engainé», «élytre» pour coléoptère et une «maie» pour cochon égorgé.
«Maïs, maïs, maïs, la voiture rouge!», dit-il chapitre 2 pour planter le décor avec moins de dix mots! Il faudrait bien aussi vous parler de l’histoire qui retourne sur elle-même un peu comme une spirale et oblige le lecteur à relire le début quand il connaît la fin. Dire les correspondances dont est truffé le livre, les allusions loufoques à lire entre les lignes, les métaphores tordues qui vous vrillent l’esprit. En somme: dire la trame poétique que tisse chaque jour Laborde entre les choses, les êtres et puis les mots. Car la «rencontre fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de vivisection», chère aux Surréalistes, devient chez Laborde la rencontre gasconne de l’Amérique et de Pluton, de la grêle et des tirelires brisées, des seins pointés et des maïs serpents (il faut lire Flammes pour comprendre). Magnifique.
Il faudrait célébrer quelques portraits musclés qui écrasent la gueule des flics, des riches, des pauvres, des bigots, des curés, mais pas en anarchiste, pas comme un pamphlétaire sautillant, mais avec sérénité et froideur, ce qui est encore pire. J’aimerais faire l’éloge des nombreuses petites phrases en gascon qui parsèment le livre sans le faire sombrer dans le régionalisme. Dire que Laborde nous conte la terre dont il vient mais sans charger l’effet, sans chauvinisme aucun. J’aimerais parler enfin des jeunes filles de Flammes qui hantent le roman: à vélo ou à pied, dans les champs, dans les granges, de poussière parfumées. Et leurs jupettes à fleurs, les fellations volées, les touffes rousses aux grandes lèvres furtivement caressées. Enfin bref, être dithyrambique et vous donner envie… Mais que dira-t-on alors? On dira: ils se connaissent. Laborde écrit dans Zoo. Voilà du copinage!
Mais où va donc la presse! On voudra que je fasse un article «objectif» sur une œuvre subjective. Quelque chose publiable dans Le Monde des livres ou dans le Figaro. Quelque chose du genre: «Christian Laborde signe avec Flammes son cinquième roman qui, inspiré d’un fait divers, décrit avec humour et style l’aventure d’un petit village de Gascogne en proie à des incendies mystérieux. Le livre fait 270 pages et n’est préfacé par personne. Certains l’aimeront, d’autres non. De toute façon je n’ai lu que la quatrième de couverture où figure un résumé et le prix: 110,00 FF T.T.C.» Ou alors… Ne faut-il pas plutôt faire un beau contre-pied? Allumer le Laborde comme il allume les autres? Dire les choses en finesse, avec subtilité. Ça y est, j’ai ma critique! Provocante, sulfureuse, vierge de tout copinage, inattaquable, froide glacée: «Flammes est un livre de merde et Christian Laborde est un gros enculé». Yann Kerninon Zoo

Duel sur le volcan, éd. Albin Michel, 1998.
Le duel Anquetil-Poulidor connut son épisode le plus glorieux le dimanche 12 juillet 1964, lors de l’ascension du puy de Dôme. Jacques et Raymond gravissent les pentes du terrible volcan coude à coude, épaule contre épaule, Jacques côté roche, Raymond côté ravin.
Christian Laborde a commencé en littérature par la voie royale : en étant censuré. Son premier roman L’Os de Dionysos lui avait valu de passer sous les fourches caudines de la justice. Quelques-uns s’étaient reconnus dans ce brûlot sulfureux et sensuel où il était notamment question où il était notamment question de libération des corps et des âmes.
Tels ces ours des Pyrénées qui incarnent selon lui à la fois une poésie et une manière de résistance, Laborde pratique le coup de griffe et le pot de miel. Ses griffes, il les a notamment sorties lors de l’aventure de L’Idiot International en compagnie de quelques camarades d’insoumission – Besson, Nabe… — emmenés par Jean-Edern Hallier, grand metteur en scène du jeu de massacre. La douceur du miel, il l’a réservée à ses idoles de la musique ou du sport.
Car Laborde a préservé cette faculté d’admiration qui est le privilège des enfants et des poètes. Une admiration qui n’est pas vaine ni mièvre mais qui nourrit de ses sucs une sensibilité de rebelle. N’appartenant à aucun clan et se tenant à l’écart des coteries, il construit depuis son Sud-Ouest une œuvre de troubadour pugnace où le lyrisme, la beauté et le merveilleux tiennent lieu d’arche d’alliance. De temps en temps, il nous envoie ses feux de joie ou de colère.
Ils déchirent le ciel et nous font entrevoir un monde perdu. On l’avait quitté voici un peu plus d’un an avec un roman intitulé La Corde à linge racontant l’histoire d’un serial voleur de petites culottes. Evidemment, ce voleur de dessous commettait ses forfaits à bicyclette car le vélo est avec le jazz et l’amour de la langue l’un des piliers de l’univers « labordien ». De son portrait d’Indurain Le Roi Miguel en passant par son hommage à Charly Gaul L’Ange qui aimait la pluie, Laborde a fait sienne la mythologie sportive et humaine – voire surhumaine – du cyclisme. Dans Duel sur le volcan, il ressuscite l’épique et tellurique combat que se livrèrent deux des plus grands champions de leur temps.
Sous sa plume, ce qui ne pourrait être qu’une banale et fastidieuse évocation se métamorphose en une sorte de tragédie grecque. Une langue chatoyante et âpre coule le long des pages comme de la lave en fusion. Elle charrie dans sa roue du fer, du feu, de la terre et du vent. Dans ce choc de titans, une échappée devient un thriller, un sprint une odyssée, une arrivée une éruption fantastique où les flammes réconcilient vainqueurs et vaincus. Laborde remporte une nouvelle fois l’étape et gagne sa place auprès de Jacques Perret et Antoine Blondin dans les rangs d’une équipe de rêve dont les mots d’ordre seraient l’amitié, le sport et la littérature. Christian Authier
La Corde à linge, roman, éd. Albin Michel, 1997.
« L’attrapera-t-on un jour, ce criminel, ce maniaque dont les actes révoltent les gens de Millac, quelque part dans les Sud-Ouest ?
Léonard Louna, celui par qui le scandale arrive, est un habitant du village. Il vit seul, estimé de tous, dans un ancien presbytère où trône la vieille machine Singer de sa mère. Un paroissien bien tranquille, amateur de poésie et de courses cyclistes ? Pas tout à fait. »
C’est une question de culture, comme on dit. Aux uns, les foules de Lourdes évoquent l’ouvrage homonyme de Huysmans. Aux autres, elles réveillent la rumeur des passages du Tour de France, dont Christian Laborde fit naguère une émouvante anthologie dans « Pyrène et les vélos ». A chacun sa religion. Contrairement à une idée répandue, Dieu n’a pas inventé les Pyrénées pour séparer la France de l’Espagne (billevesée), ni les croyants des impies par leurs aptitudes comparées à l’élévation (sornette et baliverne), mais pour distinguer au premier coup d’œil le grimpeur du non-grimpeur.
Christian Laborde, né en 1955 (troisième victoire de Louison Bobet dans la Grande Boucle) au pied du Tourmalet, à seule fin de n’en pas perdre une goutte de sueur, est le Huysmans de cette mystique-là. Le champion cycliste Luis Ocana lui est un jour apparu dans le col de Menté, un peu comme la vierge est apparue à Bernadette Soubirous. Depuis, il n’a plus cessé de vénérer la « petite reine ». Chroniqueur inspiré de la chose vélocipédique, capable de visions grandioses et de tourments à la hauteur, chantre lyrique du très pur Charly Gaul ( « L’Ange qui aimait la pluie »), biographe personnel de Miguel Indurain ( « Le Roi Miguel »), dont il a rapporté les glorieux combats avec la précision et l’enthousiasme de Joinville narrant les campagnes de Saint-Louis, Christian Laborde est aussi, pour son compte intime, un poète, un pamphlétaire et un romancier de grand talent.
On en veut pour preuve son nouveau et très allègre récit, « La Corde à linge », dont le héros est bien entendu un cycliste. Non pas un pédaleur suburbain en tenue de salarié, mais un vrai croisé du boyau, en cuissard à bretelles et maillot manches courtes. Il ne manquerait plus qu’il en aille autrement ! Léonard Louna est même un membre très caractéristique de cette aimable chevalerie. Il porte haut et loin les couleurs du club cyclotouriste de Millac et sillonne le pays sur la plus belle machine imaginée par l’homme, le guidon emmailloté d’un ruban aussi blanc que ses socquettes. Installé dans un presbytère avec pour seules compagnes sa chère bicyclette et la vieille Singer à pédale de sa maman disparue, c’est aussi un lecteur avisé de Scutenaire, Reverdy, Malaparte et Jacques Perret, en même temps que le collaborateur éminent de « l’Echo de Perlejac ».
Tout irait pour le mieux si Léonard Louna n’était affligé d’une coupable faiblesse. Amoureux en secret de la belle demoiselle Judith, la fille du notaire, dont la maison orne le flanc d’une colline où il vient parfaire ses entraînements à l’escalade, Léonard ne peut s’empêcher d’arracher en passant, aux pinces qui les exposent sur la corde à linge, les petites culottes d’icelle. D’ailleurs, cette étrange passion s’étoffe, si l’on ose dire : Léonard est le rôdeur des buanderies et des étendoirs par qui le scandale va arriver. Mais qui pourrait soupçonner ce paroissien tranquille en son presbytère, occupé de poésie et de courses cyclistes ?
On voit par là que le diable n’est jamais loin du bénitier, ni l’enfer du pénitent, et que Christian Laborde sait changer de braquet quand il faut. Inspirée d’un authentique fait divers et bercée d’un vent coquin, sa « Corde à linge » est un petit chef-d’œuvre d’élégie chatoyante et drôle. Jean-Louis Ezine, Le Nouvel Observateur
Indianoak, roman éd. Albin Michel, 1995.
L’Ange qui aimait la pluie, ed. Albin Michel, 1994
« Aucun coureur, jamais, n’a grimpé les cols comme Charly Gaul. Jean Alavoine, Vicente Trueba, René Vietto, Gino Bartali, c’était l’épopée. Gaul, c’est l’épopée et la danse, l’harmonie, l’étoile dont la légèreté, la grâce suggèrent que nous aurions des ailes…»
« Si vous avez oublié Charly Gaul, il faut lire le merveilleux ouvrage que Christian Laborde vient de lui consacrer. C’est lyrique, drôle, haletant. C’est plein de métaphores admirables, dont même les marques de vélo servent de prétexte. Ecoutez voir, par exemple, pour ceux qui savaient que c’était la Ferrari des deux roues—et Bobet avait gagné deux fois le Tour dessus : « Helyett. Helyett ! On dirait un prénom de femme, un nom d’oiseau, Alouette. » On dirait du Francis Ponge, ou de l’Apollinaire (…)
Christian Laborde a d’abord connu Gaul par son père, par transmission orale. Comme il dit : « j’ai été vacciné par un rayon ». Ce qui ne l’a pas empêché de garder la maladie du Tour de France, cette fièvre endémique qui revient toujours au mois de juillet, avec les cheveux rouges d’Yvette Horner et les feux d’artifice de notre prise de la Bastille. Cela valait bien que ce troubadour impétueux mette toutes ses qualités de style et d’imagier au populisme raffiné au service du Tour de France. Ce sont peut-être les qualités même de l’écrivain qui font aussi les champions cyclistes, la solitude, l’endurance, l’affrontement avec les forces élémentaires. »
Jean-Edern Hallier in Paris Match, 1994
Pyrène et les vélos, éd. Les Belles Lettres, Paris, 1993.
« Charly Gaul s’en va. Il a son beau maillot rouge Magnat-Debon et ses grandes ailes blanches. Il vole dans Aspin, il est libre, il a le dossard 61, et son bidon La Vittelloise pour donner à boire aux oiseaux. »
Ah les belles histoires du Tour, racontées ici avec un brio égal à celui des descendeurs…Christian Laborde aime le Tour parce que celui-ci prend parfois dans les Pyrénées les couleurs de la tragédie. Alors il redevient un môme qui, à côté de son père, applaudit les champions, écrit leurs noms à la craie sur le goudron et vocalise dans la montagne avec les voyelles de leur renommée… Bernard Pivot Lire
Danse avec les ours, éd. Régine Deforges, coll. « Coup de gueule », 1992.
Les Soleils de Bernard Lubat, illustrations de Frans Masereel, éd. Eché,1987 ; éd. Princi Négué, 1996.
Claude Nougaro, l’homme aux semelles de swing, préface de Kenneth White, percussions graphiques de Claude Nougaro, éd. Privat, 1984, grand prix de littérature musicale de l’Académie Charles Cros ; éd. Régine Deforges, 1992.
« Christian Laborde fait danser sa folie. Raconter Claude Nougaro, écrire une simple biographie lui semblait banal. Il a pris le parti fort original de lui inventer une vie, et l’imaginaire devient vite plus exact que la réalité. Cette java littéraire sur fond de jazz est une cantate à l’amitié, une drôlerie merveilleusement efficace, une réussite. » Jacques Chancel
L’Archipel de Bird, éd. Régine Deforges, 1991.
« Aldo Toomuch, gynécologue chandlerien et sensuel, vit dans un pays formidable, L’Archipel de Bird. Ayant troqué, non sans regrets, le colt 45 pour le spéculum, il explore les intimités de la nomenklatura locale et eut même le privilège insigne de faire accoucher la femme du Grand Meneur, ce qui lui valut le surnomde King Doctor.
Tyran swing, hallucinante synthèse allégorique entre Mitterrand et Ceausescu, le Grand Meneur est un dictateur impitoyable qui aime les exécutions capitales mises en scène par les grands couturiers. Paranoïaque et mégalomane, il met en marche de grands chantiers délirants et interdit même au public la plage des Roches noires, parce qu’il est persuadé que les roches en question disent du mal de lui quand le vent les fait chanter. Mais Aldo n’obéit pas, Aldo est un jouisseur tellurique qui aime trop chauffer son corps sur les roches mélodieuses. Jusqu’au jour où il est ébloui par une cavalière mystérieuse « droite, brune, au galop », qui passe sur la plage.
Alors que l’Archipel se prépare à la guerre, que le Grand Meneur mobilise tous les intellectuels, Aldo poursuit l’inconnue qui semble être à l’origine de ces tags poétiques invitant à la révolte et au rêve, pour finalement sombrer dans une passion dévorante et choisir la rébellion ouverte. Fable be-bop et lyrique, « L’Archipel de Bird » est le second roman de Laborde. Ce cap réputé difficile est franchi par l’auteur avec l’aisance des champions sûrs de leur talent. « L’Archipel de Bird » cache derrière sa désinvolture, une réelle angoisse. L’angoisse de ceux qui savent qu’il n’y aura bientôt plus que les femmes « grandes, brunes, au galop » pour nous rappeler que nous vivons le temps des soumissions honteuses. «
Jérôme LEROY in Le Quotidien de Paris
Aquarium, éd. Régine Deforges, 1990.
Nougaro la voix royale, éd. Hidalgo, 1989.
Lana Song, éd. La Barbacane, 1988.
Congo, éd. d’Utovie, 1987.
L’Os de Dionysos, éd. Eché, 1987 ; éd. Régine Deforges, 1989 ; éd. Le Livre de poche, 1991 ; éd. Pauvert, 1999.
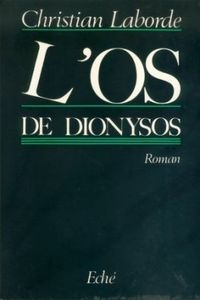






En collaboration
« Boris Vian, l’enchanteur », in revue l’Atelier du roman, 2012, no 10.
Je chante donc je suis, préface de Christian Laborde, dessins de Claude Nougaro, livre accompagnant « L’Intégrale studio », compilation de 13 CD de Claude Nougaro, éd. Universal, 2005.